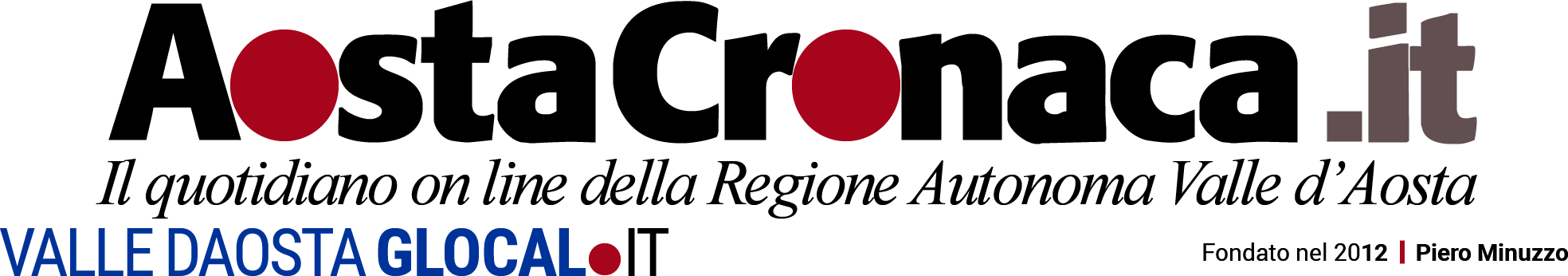C’è un momento preciso in cui le parole “democrazia”, “diritti umani”, “pace” smettono di essere valori e tornano a essere quello che troppo spesso sono sempre state: coperture lessicali. È successo di nuovo, in modo brutale, con il blitz militare ordinato da Donald Trump in Venezuela. Bombardato il Parlamento, colpito persino il mausoleo di Hugo Chávez, catturati Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores e deportati negli Stati Uniti. Non un’operazione chirurgica, non una missione multilaterale, ma un atto di forza nudo e crudo.
Russia e Cina protestano, l’Unione europea resta sgomenta, balbetta, prende tempo. L’Italia? Silenzio imbarazzato o, peggio, il solito colpo al cerchio e uno alla botte. Giorgia Meloni parla di “intervento legittimo contro i narcos”, come se bastasse una parola sporca per lavarsi le mani del diritto internazionale, delle bombe su un Parlamento, della sovranità calpestata. Come se la lotta alla droga giustificasse tutto, anche governare un Paese straniero “fino alla transizione”, come ha candidamente spiegato Trump in conferenza stampa.
E poi arriva la verità, detta senza pudore: più dei narcos, al presidente americano interessa il petrolio. Non è una gaffe, non è una fuga di notizie. È la sostanza della vicenda. Il Venezuela è seduto su una delle più grandi riserve petrolifere del pianeta e questo, oggi come ieri, vale più delle persone, delle istituzioni, delle elezioni, della pace. Vale più dei bambini, dei poveri, dei dissidenti veri e anche di quelli usati a comando.
Il paradosso è che Maduro è davvero un dittatore, un autocrate che ha svuotato la democrazia venezuelana pezzo dopo pezzo. Ma non è questo il punto. O meglio: non è il punto per Trump. Perché se la bussola fosse davvero il rispetto della persona umana, allora bisognerebbe spiegare perché certi regimi amici vengono coccolati, armati, legittimati. Perché alcuni dittatori sono impresentabili e altri diventano improvvisamente “partner strategici”.
Da cronista che lavora in Valle d’Aosta, in una terra piccola ma con una memoria lunga, questa storia suona fin troppo familiare. Qui sappiamo bene cosa significa difendere l’autonomia, la dignità delle istituzioni, il rispetto delle comunità. Qui sappiamo che quando il più forte decide di “governare” qualcun altro per il suo bene, di solito non lo fa gratis. E quasi mai lo fa per altruismo.
Fa impressione il silenzio complice del governo italiano. Un silenzio che pesa come una dichiarazione. L’Italia, che nella Costituzione ripudia la guerra, si rifugia in formule ambigue, in mezze frasi, in giustificazioni comode. Nessuna parola sul Parlamento bombardato, nessuna sul precedente pericolosissimo di uno Stato che si arroga il diritto di occupare e amministrare un altro Paese sovrano. Meglio non disturbare l’alleato americano, meglio non incrinare equilibri, meglio non fare domande scomode sul petrolio.
Ma le domande restano. E sono tutte lì, davanti a noi: che valore ha la democrazia quando diventa selettiva? Che credibilità hanno i diritti umani quando vengono invocati solo dove conviene? Che senso ha parlare di pace se le bombe diventano uno strumento ordinario di politica economica?
Il blitz in Venezuela non è una vittoria della libertà. È l’ennesima dimostrazione che, nel grande gioco globale, la persona umana conta meno di un barile di greggio. E che anche l’Occidente, quando si tratta di affari seri, è disposto a voltarsi dall’altra parte. Con buona pace delle parole, delle bandiere e delle lezioni morali.
Democrazie, dittatori e petrolio
Il arrive un moment précis où les mots « démocratie », « droits humains », « paix » cessent d’être des valeurs et redeviennent ce qu’ils ont trop souvent été : des paravents rhétoriques. Cela s’est produit une fois de plus, de manière brutale, avec le blitz militaire ordonné par Donald Trump au Venezuela. Le Parlement a été bombardé, le mausolée d’Hugo Chávez touché, Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores capturés et transférés de force aux États-Unis. Pas une opération chirurgicale, pas une mission multilatérale, mais un acte de force à visage découvert.
La Russie et la Chine protestent, l’Union européenne reste sidérée, bafouille, temporise. Et l’Italie ? Un silence embarrassé ou, pire encore, le sempiternel coup au cerceau et à la bouteille. Giorgia Meloni parle d’« intervention légitime contre les narcos », comme s’il suffisait d’un mot sale pour se laver les mains du droit international, des bombes sur un Parlement, de la souveraineté piétinée. Comme si la lutte contre la drogue pouvait tout justifier, y compris le fait de « gouverner un pays jusqu’à la transition », comme l’a expliqué sans détour Trump lors de sa conférence de presse.
Puis vient la vérité, dite sans aucune pudeur : plus que les narcos, ce qui intéresse le président américain, c’est le pétrole. Ce n’est ni une gaffe ni une indiscrétion. C’est le cœur même de l’affaire. Le Venezuela repose sur l’une des plus grandes réserves pétrolières de la planète et cela, aujourd’hui comme hier, vaut plus que les personnes, les institutions, les élections et la paix. Cela vaut plus que les enfants, les pauvres, les vrais opposants et aussi ceux que l’on instrumentalise à la demande.
Le paradoxe, c’est que Maduro est réellement un dictateur, un autocrate qui a vidé la démocratie vénézuélienne de sa substance, morceau après morceau. Mais ce n’est pas là le point central. Ou plutôt : ce n’est pas le point pour Trump. Car si la boussole était réellement le respect de la personne humaine, il faudrait alors expliquer pourquoi certains régimes amis sont choyés, armés, légitimés. Pourquoi certains dictateurs sont infréquentables tandis que d’autres deviennent soudain des « partenaires stratégiques ».
Pour un chroniqueur qui travaille en Vallée d’Aoste, dans une terre petite mais dotée d’une longue mémoire, cette histoire sonne étrangement familière. Ici, nous savons bien ce que signifie défendre l’autonomie, la dignité des institutions, le respect des communautés. Ici, nous savons que lorsque le plus fort décide de « gouverner » quelqu’un d’autre pour son bien, il ne le fait généralement pas gratuitement. Et presque jamais par altruisme.
Le silence complice du gouvernement italien est frappant. Un silence qui pèse comme une déclaration. L’Italie, dont la Constitution répudie la guerre, se réfugie dans des formules ambiguës, des demi-phrases, des justifications commodes. Pas un mot sur le Parlement bombardé, pas un mot sur le précédent extrêmement dangereux d’un État qui s’arroge le droit d’occuper et d’administrer un autre pays souverain. Mieux vaut ne pas déranger l’allié américain, mieux vaut ne pas troubler les équilibres, mieux vaut ne pas poser de questions gênantes sur le pétrole.
Mais les questions demeurent. Et elles sont toutes là, sous nos yeux : quelle valeur a la démocratie lorsqu’elle devient sélective ? Quelle crédibilité ont les droits humains lorsqu’on ne les invoque que là où cela arrange ? Quel sens a-t-il de parler de paix si les bombes deviennent un instrument ordinaire de politique économique ?
Le blitz au Venezuela n’est pas une victoire de la liberté. C’est une démonstration de plus que, dans le grand jeu mondial, la personne humaine compte moins qu’un baril de brut. Et que même l’Occident, lorsqu’il s’agit d’affaires sérieuses, est prêt à détourner le regard. Au grand dam des mots, des drapeaux et des leçons de morale.